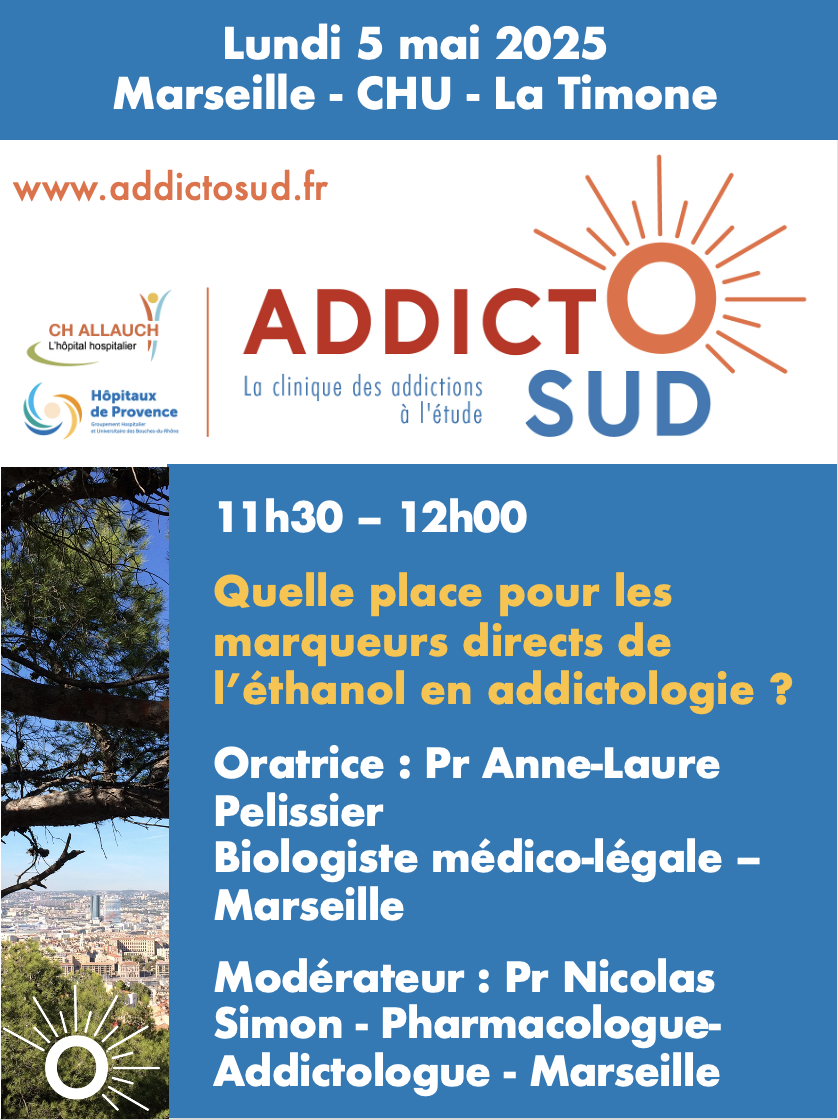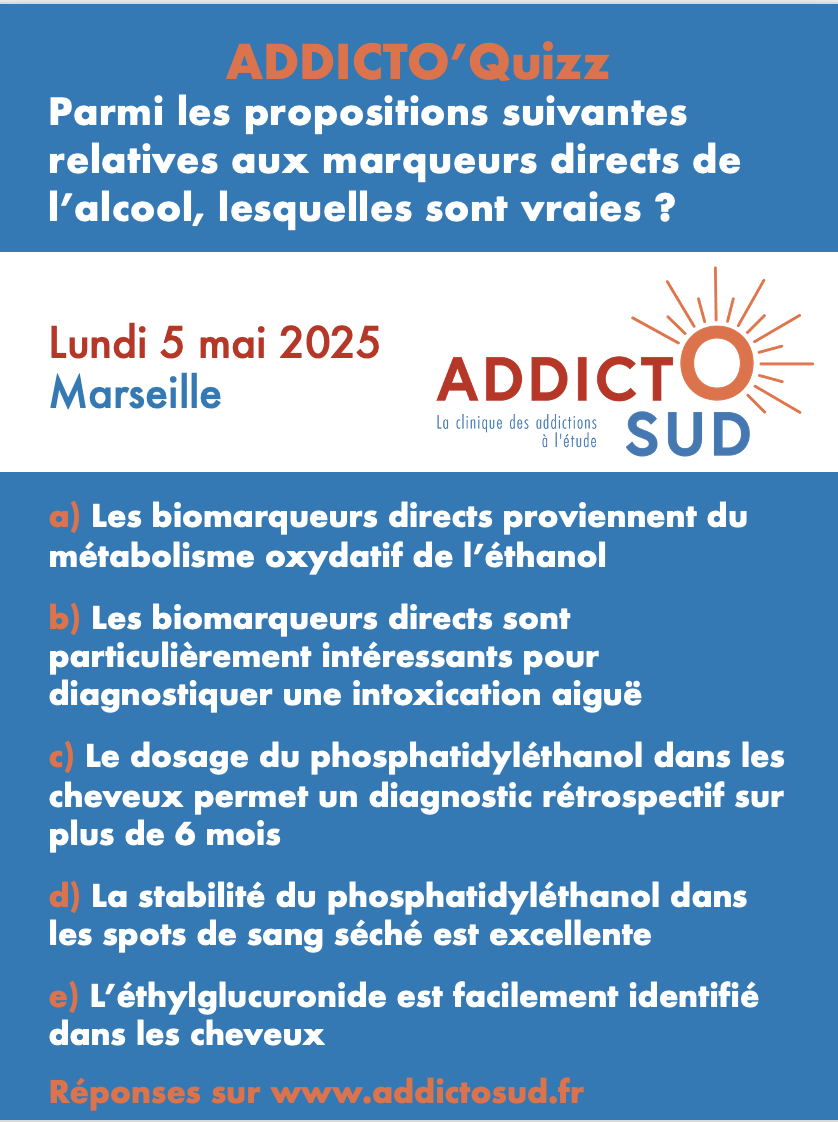L’éthanol reste la substance psychoactive la plus consommée en France et l’impact de l’alcoolodépendance en termes de santé publique est majeur. L’utilisation de biomarqueurs d’une consommation chronique d’alcool est pertinente dans de nombreuses indications cliniques. Il existe deux catégories de biomarqueurs d’une consommation chronique d’éthanol : les biomarqueurs indirects, utilisés depuis des décennies, et les biomarqueurs directs d’utilisation beaucoup plus récente. Les biomarqueurs indirects (transaminases, volume globulaire moyen (VGM), gamma-glutamyl transpeptidase (g-GT), transferrine désialylée (CDT)) qui sont des paramètres physiologiques modifiés par la consommation chronique d’alcool. Leur utilisation présente de nombreuses limites (faible sensibilité et spécificité, variabilité interindividuelle etc.). Les biomarqueurs directs sont représentés par l’éthanol lui-même et certains de ses métabolites. Le métabolisme de l’éthanol est essentiellement oxydatif (90%) ; il fait intervenir 3 voies métaboliques, l’alcool déshydrogénase (ADH), le cytochrome P450 (CYP2E1) et la catalase, et aboutit à la formation d’acétaldéhyde, métabolite non spécifique d’une consommation d’alcool. Parallèlement, un métabolisme non oxydatif mineur (10%) aboutit à la formation de métabolites spécifiques, l’éthylglucuronide (EtG), l’éthylsulfate (EtS), le phosphatidyléthanol (PEth) et les esters éthyliques d’acides gras (FAEEs). Ces métabolites, même si leurs concentrations sont faibles, présentent l’avantage d’être spécifiques d’une consommation d’alcool et de posséder une fenêtre de détection beaucoup plus longue que l’éthanol lui-même. Les techniques analytiques modernes permettent de doser ces molécules aussi bien dans des milieux biologiques conventionnels (prélèvements sanguin et urinaire), que sur des spots de sang séché (DBS), moins invasifs, ou encore sur des matrices alternatives telles que les cheveux qui permettent d’étendre la fenêtre de détection à plusieurs mois. L’utilisation de ces marqueurs constitue une aide au diagnostic d’alcoolodépendance, à la surveillance de l’abstinence, à la détection des rechutes, ainsi que dans des indications plus ciblées, notamment l’évaluation de la consommation d’alcool chez des candidats à la transplantation hépatique ou encore le dépistage d’une exposition prénatale à l’alcool (PAE) et la prévention des troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale.
Anne-Laure Pélissier, Laboratoire de Toxicologie Médicolégale, CHU Timone, APHM
Nicolas Fabresse, Laboratoire de Pharmacocinétique et Toxicologie, CHU Timone, APHM
Réponses ADDICTO’Quizz : d – e